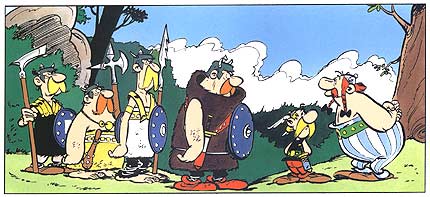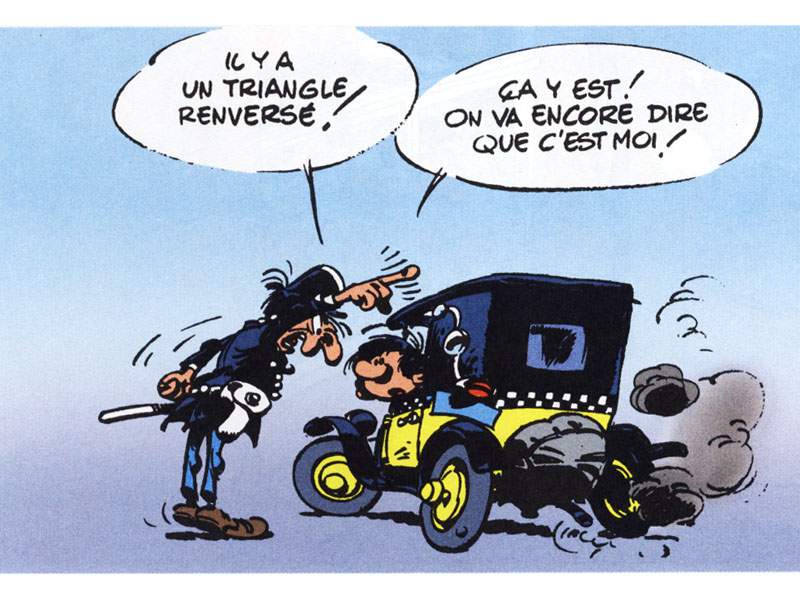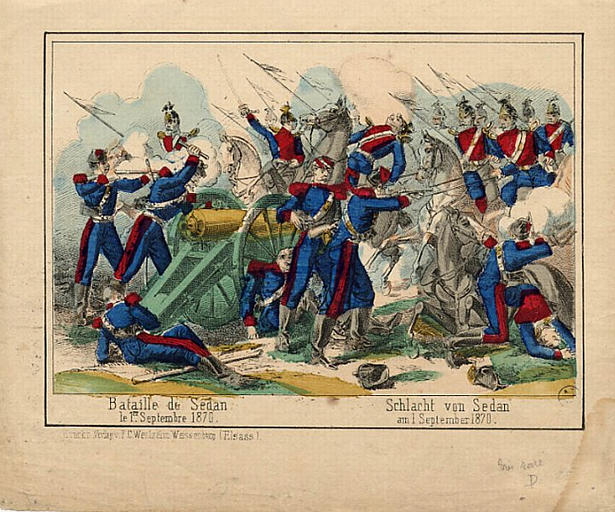A Berlin, un serveur italien m’a appris l’existence d’une recette légendaire originaire de la Loire : le rôti de hamster. Info ou intox alimentaire?
Le serveur du restaurant italien Herr Rossi, dans le quartier de Prenzlauer Berg, m’entends parler français avec une amie de Paris, alors que nous nous gavons d’une sublime série de raviolis à la citrouille sauce sauge fraîche. Il nous alpague alors dans la langue de Molière, avec un accent et une gouaille digne de Robert Benigni, ne cessant de la ramener sur la supériorité de la gastronomie italienne pour nous faire tiquer.
Avez-vous déjà remarqué? Toute la planète se rit de nous autres, pauvres Français, accusés de faire de nos ventres un étendard politique. Mais merde, quoi : la gastronomie française n’est-elle pas devenue « patrimoine de l’Humanité » en novembre 2010? (Car oui, amis lecteurs du monde entier, la France a osé : elle a déposé une demande d’entrée au patrimoine mondial pour sa gastronomie, au comité intergouvernemental de l’Unesco réuni à Nairobi (Kenya). Cf l’article de RFI ici. Vous avez le droit de rigoler.)
Ce serveur ne laisse donc pas de me faire rire, je dois l’avouer. Il se trémousse tout en nous asticotant : le Pinot Grigio est meilleur que le Chablis, la ciabatta meilleure que la baguette, oui signora. Finalement, je lui demande où il a appris à parler un français aussi cyranesque.
« Ah, j’ai eu un chéri français, une bombe, mais il m’a brisé le cœur », réplique notre serveur en prenant des poses de Madame Bovary. Il ajuste ses lunettes de vue sur son nez aquilin. « Mais avec lui, je ne mangeais que des sandwichs, on faisait l’amour tout le temps » (- on se marre. Tout le resto nous mate, mais personne ne parle français à part nous, c’est avantageux n’est-ce pas).
« Quand mon chéri m’a emmené chez sa grand-mère dans la Loire, je me suis dit : hmmm, enfin! La bonne cuisine française de mémé, faite maison, mijotée pendant des heures! Mais tu sais pas ce que j’ai bouffé, non?!! »
Le serveur, pris dans le feu de son histoire, pose les assiettes qu’il devait porter à la table voisine. Les clients font la gueule en voyant leurs mets refroidir.
« Tu vois, ces petits animaux, là, qui courent dans des roues? Les hamsters! Elle a pris un petit hamster, tout mignon, dans sa cage… » Il nous transperce du regard, instant suspendu. Ma pote et moi, on ne se doute de rien.
« … VIVANT! et Hop! » Il frappe du plat de la main sur la table, les verres valdinguent. « Elle l’a tué avec un couteau, là, devant moi! » Il porte ses mains à son visage, exprimant à nouveau l’horreur de cet instant passé. « Il y avait du sang partout! » ajoute-t-il en poussant un petit cri. Mon amie Sophie me regarde, bouche bée, et balbutie : « mais non… ce n’est pas possible… » Et lui de poursuivre, rongeant ses poings : « si! Et elle l’a fait rôtir! »
Cri d’horreur de Sophie et de moi-même. Non mais, c’est ignoble, tout de même – un hamster innocent, rôti comme une vulgaire dinde.
« Et avec quoi l’a-t-elle fait rôtir? » demandais-je, curieuse. « Avec des pommes de terre! » s’exclame le serveur d’une voix stridente, « la vieille m’a dit que c’est une spécialité française! ».
L’incrédulité se lit sur nos visages. C’est déjà difficile de se représenter une grand-mère de nos campagnes trucidant un cochon d’inde avec un couteau de boucher, mais imaginer qu’elle puisse le faire rôtir avec des patates, cela dépasse l’entendement, excusez-moi.
D’abord, un hamster est beaucoup trop petit pour être un plat familial, sa taille laissant à peine espérer une portion individuelle surgelée de chez Picard à glisser au micro-ondes pendant la pause-dèj de bureau. Ensuite, les pommes de terre rôties, en France, ça se mange avec du confit de canard, un carré d’agneau ou du poulet, à la rigueur avec une omelette dans sa version self-service de station de ski, mais certainement pas avec du rongeur. Sophie et moi sommes unanimes. Ce serveur se paie notre poire.
Mais ce bel Italien ne lâche pas le morceau. Alors que je règle l’addition, il me saisit le poignet avec force, et me dit : « eh, tu sais, ce n’est pas parce que je suis Italien que je suis un menteur, hein. Je te jure que c’est vrai. Sur la tête de la Madone! Et tu sais ce que ça veut dire pour nous, hein! »
Ouais, c’est ça**. Et nous, les Français, nous sommes les rois de la gastronomie.
*Restaurant Herr Rossi, Winsstraße 11, Berlin (Prenzlauer Berg)
** Un doute subsiste quand même… un de mes lecteurs aurait-il déjà mangé du hamster dans la Loire? Toutes informations bienvenues…
The post Rôti de hamster : une tradition française légendaire appeared first on Génération Berlin.